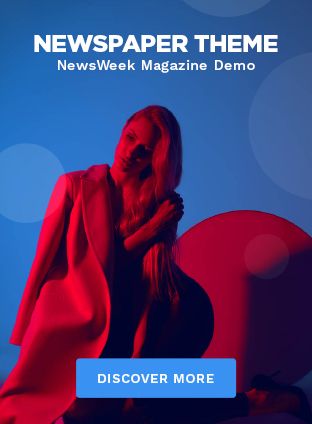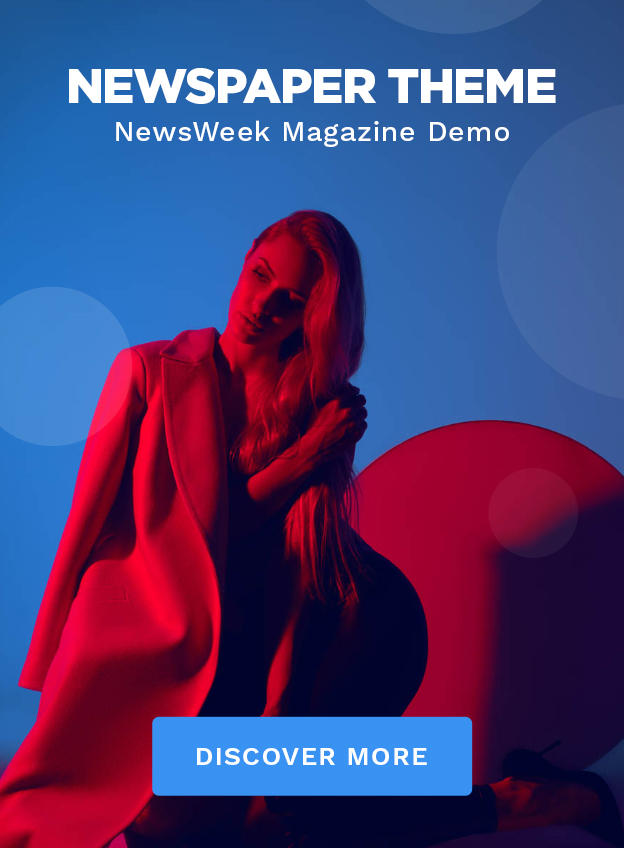Témoin immuable de la succession de plusieurs civilisations à Mila, la mosquée Abou Al-Mouhadjir Dinar en cours de restauration
Restauration de la mosquée Abou Al Mouhadjir Dinar à Mila
La restauration de la mosquée Abou Al Mouhadjir Dinar, également connue sous le nom de mosquée Sidi Ghanem, située dans la vieille ville de Mila, est en cours dans le but de restaurer son éclat et de préserver ce monument historique, symbole d’un riche patrimoine culturel témoin de multiples civilisations.
Contexte historique
La mosquée, construite autour de l’année 670 de notre ère (ou 59 de l’Hégire) par l’émir Abou Al Mouhadjir Dinar sur les vestiges d’une église byzantine, est considérée comme la première mosquée en Algérie et la deuxième en Afrique du Nord, après celle de Kairouan en Tunisie. Le monument a été conçu avec des matériaux caractéristiques des civilisations romaine et byzantine, tels que des pierres polies, du marbre et des briques réfractaires, tout en respectant les principes de l’architecture islamique de l’époque.
À l’origine, la mosquée présentait une structure rectangulaire avec 42 colonnes, 7 plateformes ornées de carreaux stylisés, et 4 couloirs, accessible par une imposante porte en bois en deux battants. Un arc en briques décoré d’inscriptions arabes en caractères coufiques surmontait cette entrée. La mosquée a conservé sa forme archéologique jusqu’en 1839, sans modifications notables selon les archives historiques de la période islamique précédant l’arrivée des colonisateurs français.
Impact de l’occupation française
L’occupation française a eu des conséquences désastreuses sur la mosquée : le minaret a été démoli, le toit remplacé et des annexes inappropriées ont été ajoutées, notamment pour servir de caserne et d’hôpital, tandis que le reste était utilisé comme écurie, dégradant ainsi l’édifice. Après l’indépendance, le site fut temporairement utilisé comme annexe d’école avant d’être abandonné, ce qui entraîna des dégradations supplémentaires dues à des facteurs environnementaux et humains. Ce n’est qu’après sa classification comme "bien culturel dans une zone protégée" par le secteur de la culture qu’il a été possible de lancer un projet de restauration.
Programme de restauration
Depuis 2019, un bureau d’étude a été désigné pour mener des investigations techniques en vue de réhabiliter cet édifice. La première phase des travaux a été considérée comme urgente et a inclus la consolidation de la structure, le traitement des fissures, ainsi que la reconstruction de parties endommagées et la réparation de la toiture. Actuellement, les travaux de restauration proprement dits, entamés en 2024, sont prévus pour durer 27 mois et se déroulent à un rythme satisfaisant, avec une progression d’environ 50%, selon Nadir Kahla, un spécialiste en archéologie représenté au sein du bureau d’études.
L’accent est particulièrement mis sur le respect des méthodes et des matériaux traditionnels pour préserver l’intégrité architecturale de l’édifice. Cela implique la restauration des murs intérieurs, l’ajustement des colonnes et la réparation de la toiture avec des matériaux analogues à ceux utilisés lors de la construction originale.
Objectifs futurs
À travers ce projet, les autorités locales cherchent à transformer la mosquée en un centre d’interprétation muséale, permettant aux visiteurs d’approfondir leur compréhension des différentes phases de l’histoire algérienne. Ce projet vise à reconnecter le lieu avec son passé glorieux et à offrir aux futurs visiteurs une immersion dans l’époque à laquelle la mosquée a été fondée, tout en sauvegardant son esthétique et ses caractéristiques d’origine.
En conclusion, la restauration de la mosquée Abou Al Mouhadjir Dinar représente non seulement une démarche de préservation du patrimoine, mais également un projet éducatif qui promet d’enrichir la culture locale et de renforcer l’identité historique de la ville de Mila. Le projet est un témoignage de la volonté des autorités culturelles de valoriser leur patrimoine et d’assurer la transmission d’une mémoire collective riche et complexe aux générations futures.