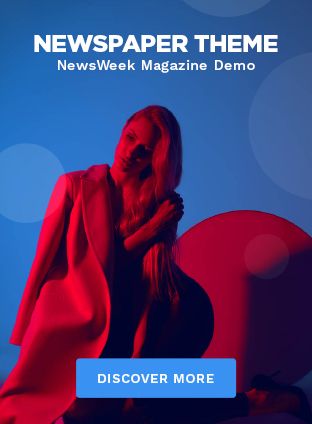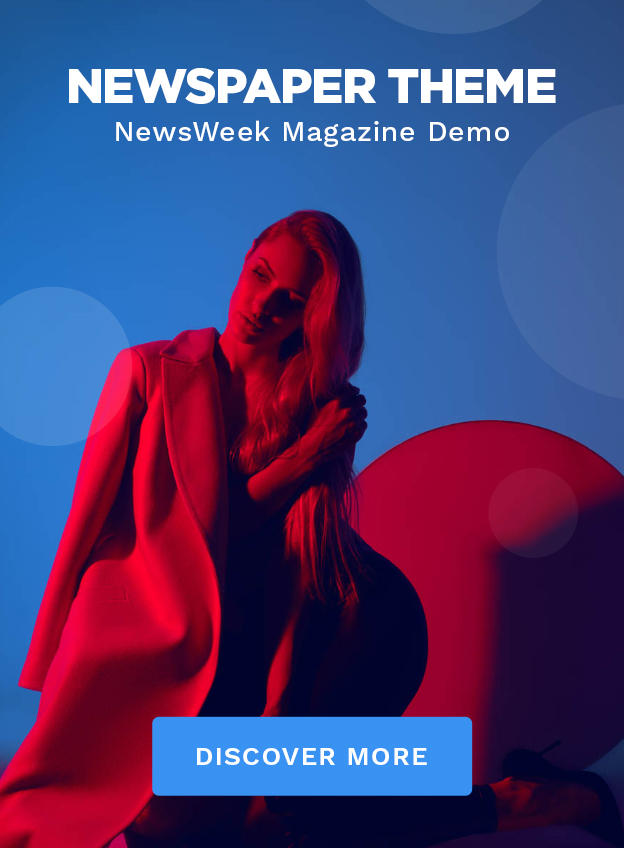le liège algérien, une ressource pillée au profit des colons
L’exploitation coloniale du liège algérien : Histoire et conséquences
Le liège algérien, objet de forte convoitise dès les débuts de la colonisation française en Algérie, a subi une exploitation sauvage pendant 132 ans, sous la houlette d’une administration coloniale peu soucieuse de la durabilité de cette précieuse ressource forestière.
Dès lors, les 400,000 hectares de forêts de chêne-liège ont été soumis à une exploitation intensive en réponse à la montée de la demande mondiale pour cette matière. Selon les données compilées par l’administration coloniale, la récolte de liège a été augmentée de manière continue, sans respecter les principes de gestion durable, ce qui a gravement affecté la santé des arbres. À la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, la production algérienne représentait environ deux tiers de celle de la France, qui, de son côté, fournissait plus d’un quart de la production mondiale.
Les autorités coloniales ont justifié leur exploitation par une politique de "foresterie rationnelle", exploitant ainsi les forêts au-delà de leur capacité de régénération. Cette approche a été accompagnée de législations qui ont progressivement restreint l’accès aux forêts pour les Algériens, poussant à la mise en place d’un système de concession. Dès 1840, le régime de concessions a été implanté, favorisant principalement des concessionnaires privés français et européens pour de longues durées.
Les premières récoltes, en 1847, ont atteint 447 quintaux de liège brut, mais la situation s’est détériorée rapidement. Des décrets ont été promulgués pour favoriser davantage les concessionnaires forestiers, leur permettant de récupérer des sections brûlées ainsi que des portions non touchées sans frais. À partir de 1865, les forêts concédées ont pu être aliénées, ce qui a conduit à l’accaparement de véritables terres par les colons; en l’espace de vingt ans, l’État colonial avait pris possession de 275,000 hectares de forêts de chêne-liège sur les 400,000 initialement recensés.
Le tournant du XXème siècle a été marqué par la montée de la productivité. Entre 1900 et 1915, la surface productive est passée à 250,000 hectares; plus de 27 millions d’arbres ont été exploités, et la production moyenne par hectare atteignait environ 60 kg. Cette agression continue, particulièrement après la Première Guerre mondiale, a résulté en une intensification de l’exploitation pour compenser les pertes économiques en Europe. La production par arbre a bondi, atteignant une moyenne de 10 kg, tandis que la production globale a culminé à 553,919 quintaux de liège en 1937.
Cependant, cette surexploitation s’est accompagnée d’une dégradation notable de la ressource. Les administrateurs forestiers ont constaté, en 1930, un épuisement critique des peuplements de chêne-liège, entraînant une chute draconienne de la production entre 1930 et 1946. L’industrialisation autour du liège a également vu le jour, alors que des usines se multipliaient à Alger, Béjaïa, Jijel et Collo, transformant le liège en divers produits allant des bouchons aux semelles.
Ce tableau dépeint les conséquences d’une mauvaise gestion des ressources naturelles sous une domination coloniale cherchant avant tout à maximiser ses profits, parfois aux dépens des écosystèmes locaux et de la population algérienne. La réalité de l’exploitation du liège en Algérie pendant cette période vient donc illustrer non seulement les méthodes d’accaparement de terres, mais aussi les effets à long terme de l’exploitation non durable des ressources naturelles. Les législations restrictives, les concessions et la prédominance de l’intérêt colonial sont les héritages d’une époque où l’Algérie a été considérée comme une simple richesse à exploiter sous le contrôle colonial.
En conclusion, l’histoire du liège algérien sous la colonisation française est emblématique des ravages causés par une gestion impérialiste des ressources naturelles. En dépit des promesses d’une "foresterie rationnelle", cette exploitation a non seulement épuisé les forêts de chêne-liège algériennes, mais a également mis en danger l’écosystème local et les traditions, tout en transformant le liège en un simple produit de consommation destiné à alimenter une industrie dominée par des intérêts étrangers.