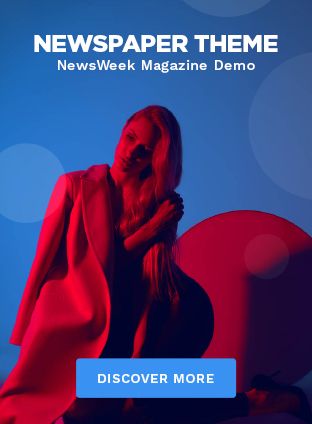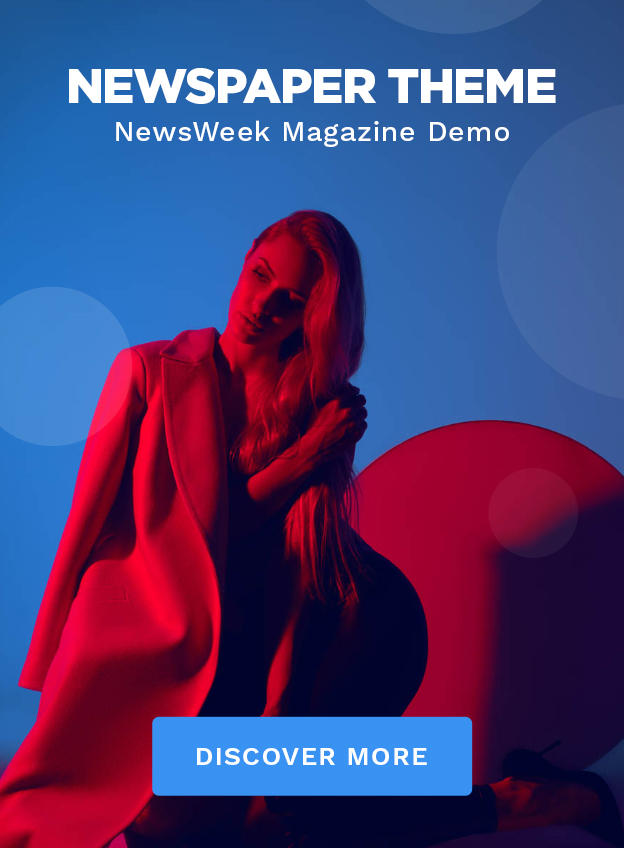Le 8 avril 1871, Cheikh Belhaddad proclamait l’insurrection contre le colonialisme français
Cheik Belhaddad et l’insurrection de 1871 en Algérie : Un acte de bravoure contre le colonialisme français
Le 8 avril 1871, l’histoire de l’Algérie a été marquée par le courage de Cheik Belhaddad, né Mohamed Ameziane Belhaddad. Ce jour-là, lors d’un rassemblement populaire à Bejaia, il proclama une insurrection générale contre le colonialisme français, incitant la foule à se soulever et à porter les armes pour libérer leur terre. Avec une intensité émotionnelle, il déclara : « Nous allons le (l’occupant) jeter à la mer comme je jette ma canne à terre », un geste qui suscita une vague d’enthousiasme au sein des populations environnantes.
La réponse à cet appel fut massive, mobilisant non seulement les habitants de la vallée de la Soummam, mais aussi ceux des régions des Bibans, du Djurdjura, de l’Algérois, du Constantinois et des Aurès. Ainsi, une armée de 200 000 hommes se leva, selon l’historien Idir Hachi dans son ouvrage "1871, une levée en arme pour l’honneur de la patrie". Ce mouvement de révolte s’inscrivait dans une longue lignée de résistance contre le colonialisme, succédant à des rébellions emblématiques telles que celles de l’Émir Abdelkader, des Zaâtacha, de la Dahra, de Fadhma N’Soummer, et OUled Sid Chikh. Ces soulèvements successifs témoignaient d’un refus de plus en plus puissant et enraciné de la présence coloniale en Algérie.
Malgré son grand âge – 80 ans – et son manque d’expérience militaire, Cheik Belhaddad, connu comme un leader spirituel de la confrérie Rahmaniya, ne recula pas devant l’idée de prendre les armes. Il comprenait la gravité de la situation et la dureté de ce qui l’attendait, affirmant que cela serait une épreuve difficile, mais qu’il était déterminé à faire face à la lutte pour la liberté. Sa volonté fut renforcée par la passion de ses fils, El Aziz et M’hand, ainsi que par le soutien d’El Hadj-El-Mokrani, qui avait déjà lancé des offensives avec ses 15 000 hommes depuis le 15 mars.
Le soulèvement dura près d’un an, mais se solda par de terribles représailles de la part des autorités coloniales. Les événements furent marqués par des massacres de grande envergure, des incendies de fermes et la déportation de centaines de personnes vers les bagnes de Nouvelle-Calédonie, y compris les deux fils de Cheik Belhaddad.
Malheureusement, le héros de cette révolte fut arrêté en juillet 1871 à Seddouk. Emprisonné d’abord à Bejaia, puis transféré à Constantine, il fut condamné à cinq ans d’emprisonnement, malgré son état de santé fragile. Il mourut peu après son incarcération, laissant derrière lui un héritage de bravoure et de résistance. Ses restes furent initialement enterrés à Constantine, mais en juillet 2009, un mausolée a été érigé à Seddouk pour lui rendre hommage et accueillir son corps.
L’insurrection de 1871 et le rôle central de Cheik Belhaddad sont des symboles puissants de la lutte algérienne contre le colonialisme. Cet événement fut l’expression d’un désir ardent de liberté et d’une solidarité populaire face à l’oppression. Le courage et la détermination de Belhaddad, malgré son grand âge et son statut de chef spirituel, illustrent la profondeur de l’engagement des Algériens dans leur quête d’indépendance. Son héritage perdure dans la mémoire collective du peuple algérien et continue d’inspirer les luttes pour la justice et la dignité.
En résumé, l’insurrection de 1871, en grande partie orchestrée par Cheik Belhaddad, a été un tournant crucial dans l’histoire récente de l’Algérie. Face à l’autoritarisme colonial, cet acte de bravoure a ouvert de nouvelles voies de résistance qui résonnent encore aujourd’hui, témoignant d’une lutte continuelle pour l’autodétermination et la souveraineté nationale.