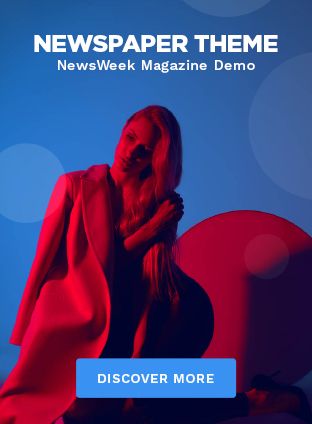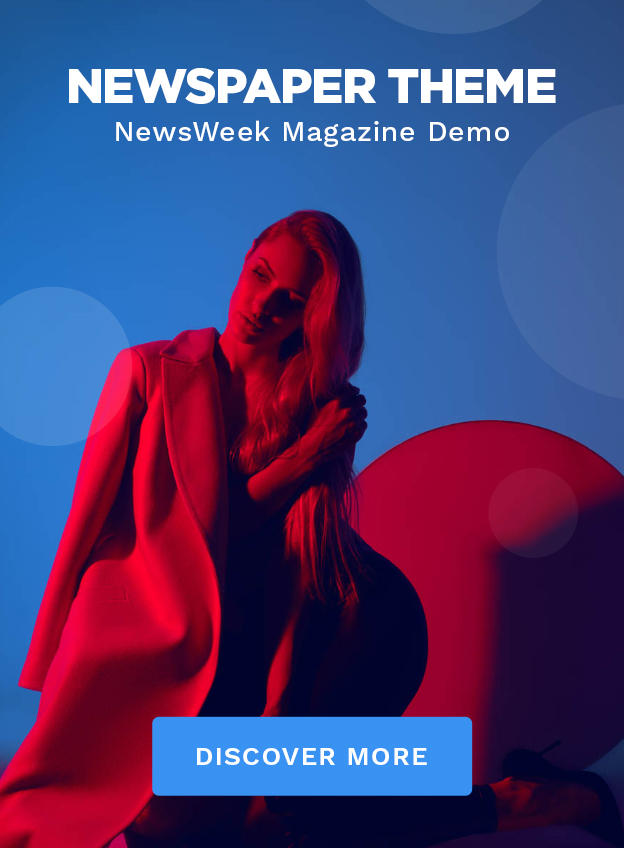Quand la France accuse l’Algérie en oubliant ses propres privilèges
La France et l’Algérie : Asymétrie des Avantages Bilatéraux
Récemment, l’extrême droite française, représentée par des figures comme Bruno Retailleau, a intensifié ses attaques contre l’Algérie, l’accusant de tirer profit des aides françaises et de négliger les accords signés entre les deux nations. Cette rhétorique accusatoire, qui semble délibérément ignorante des réalités, omet le fait que c’est principalement la France qui a exploité ces relations à son avantage.
La situation a pris une nouvelle tournure la semaine dernière, lorsque le ministère des Affaires étrangères algérien a convoqué l’ambassadeur français, Stéphane Romatet, pour aborder un sujet longtemps négligé par Paris : la question des propriétés immobilières en Algérie utilisées par la France. Actuellement, 61 biens immobiliers sont occupés par la France en Algérie, pour des loyers ridiculement bas. Parmi ceux-ci, le siège de l’ambassade française couvre 14 hectares avec un loyer si dérisoire qu’il pourrait difficilement couvrir le coût d’une modeste chambre à Paris. De plus, la résidence de l’ambassadeur, connue sous le nom "les Oliviers", est louée pour un franc symbolique, avec un tarif inchangé depuis 1962, jusqu’en août 2023. Cette générosité est en contradiction avec le traitement qu’Algérie reçoit de la part de la France.
Cette situation est loin d’être un cas isolé. De nombreux accords bilatéraux ont été signés, principalement pour le bénéfice des intérêts français. Prenons l’exemple de l’accord de 1968, qui fixe le statut des Algériens en France et leur accorde un régime migratoire spécifique, de manière à mieux répondre aux besoins de main-d’œuvre de l’économie française. Paris se plaint fréquemment de cet accord, mais il y a une omission notable : les avantages que la France en retire, ayant ainsi bénéficié de l’importante contribution des travailleurs algériens à la reconstruction et au développement économique de la France. En revanche, l’Algérie ne jouit d’aucun privilège semblable en France.
Un autre accord notable est celui de 1994, qui régule de nombreux aspects des relations économiques entre les deux pays. Dans la réalité, ces accords ont permis aux entreprises françaises d’opérer en Algérie dans des conditions très favorables, tandis que les entreprises algériennes rencontrent des obstacles pour entrer sur le marché français. Une fois encore, les bénéfices de ces accords sont unilatéraux, favorisant l’économie française au détriment des intérêts algériens.
Si la France souhaite réellement discuter de la réciprocité dans les relations bilatérales et du respect des engagements, il est alors judicieux d’analyser qui a vraiment tiré profit de ces accords. Ce dialogue pourrait mettre en lumière la réalité des interactions entre les deux nations et clarifier les allégations sur le non-respect des accords.
Il est grand temps que les discours trompeurs, destinés à manipuler l’opinion publique, prennent fin. Contrairement à ce que les discours d’extrême droite pourraient suggérer, l’Algérie ne peut pas être considérée comme le profitant de cette relation; la France en a été le bénéficiaire principal depuis des décennies, exploitant chaque accord à son propre avantage. Si la France veut exiger un examen des comptes, elle doit d’abord être prête à se soumettre au même examen.
En résumé, la rhétorique accusatoire à l’encontre de l’Algérie par certains acteurs politiques français souligne les tensions persistantes entre les deux pays, souvent exacerbées par des inégalités historiques et des perceptions déformées des relations bilatérales. Le moment est venu pour une évaluation honnête des accords passés et de leurs implications pour les deux parties, tout en reconnaissant les déséquilibres qui ont prévalu dans ces relations. Les discussions sur ces sujets doivent être menées de manière transparente et constructive, afin de créer un terrain d’entente plus équilibré et mutuellement bénéfique.