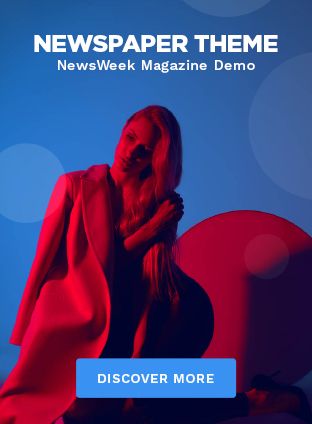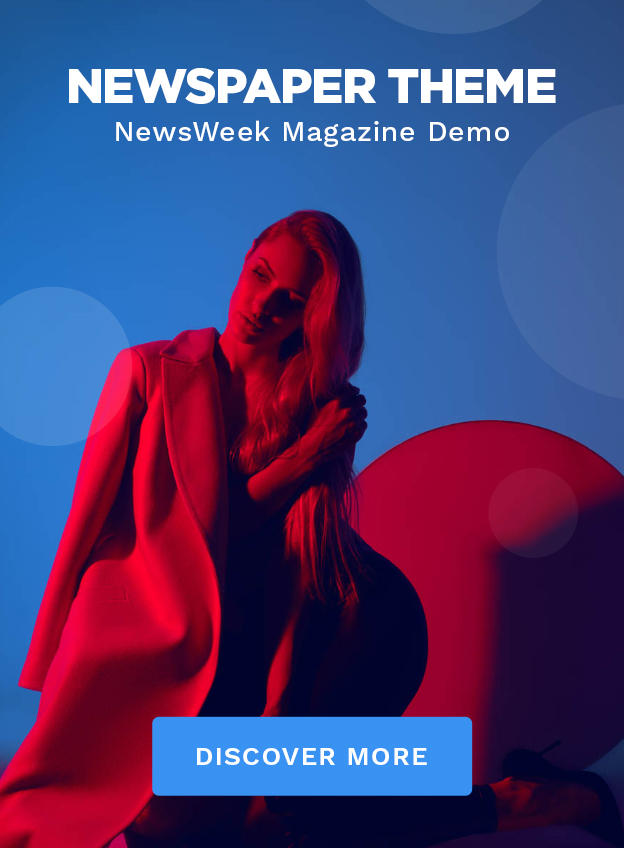regard lucide sur le colonialisme et dénonciation des exactions commises par la France
Mouloud Feraoun : Une Voix Engagée de la Résistance Algérienne
Mouloud Feraoun (1913-1962), écrivain et instituteur, a été un témoin privilégié des tragédies et des espoirs qui ont marqué la Guerre de libération nationale algérienne. Par l’intermédiaire de son œuvre, il a exprimé une critique acerbe du colonialisme français, mettant en lumière les atrocités infligées aux Algériens et son engagement indéfectible en faveur de l’indépendance du pays. Son "Journal 1955-1962", publié à titre posthume en 1962, constitue un document précieux qui reflète les réalités brutales de cette période tumultueuse.
Dans son journal, Feraoun évoque les horreurs de la guerre, décrivant des scènes de violence et de désespoir. Par exemple, il fait état de bombardements ayant détruit des villages, plongeant les habitants dans la terreur et la désolation. Il écrit : "Trois villages ont été bombardés et incendiés. Les hommes ont été emmenés, les femmes et les enfants errent à travers les douars à la recherche d’un asile." À travers ses mots, il capte la douleur et la souffrance des Algériens, illustrant la brutalité de l’armée coloniale. Ses descriptions, empreintes d’émotion, révèlent comment la guerre a profondément affecté la vie quotidienne et la psyché des populations.
Sa lutte pour l’indépendance s’accompagne d’une réflexion sur l’avenir. Feraoun exprime un espoir tenace pour l’Algérie, affirmant : "Je crois en l’avenir de mon pays. Je crois en la capacité des Algériens à construire une nation libre et juste." Sa foi en son peuple et sa conviction que l’indépendance est inévitable alimentent son engagement. Cette dualité entre le désespoir et l’espoir traverse son œuvre, rendant son témoignage d’autant plus poignant.
Mouloud Feraoun est également connu pour ses romans, notamment "Le Fils du Pauvre" (1950) et "La Terre et le Sang" (1953). Ces récits autobiographiques traitent des injustices sociales et des inégalités ressenties par les Algériens sous le joug colonial. À travers ces œuvres, il dénoncera les injustices que subissent ses compatriotes tout en plaidant pour une Algérie libre. Même si son engagement politique n’était pas toujours affiché de manière ostentatoire, son fils, Ali Feraoun, affirme que son père avait des liens étroits avec les leaders de la Révolution, indiquant que ses réflexions dans le journal révèlent une pensée critique sur le colonialisme.
Né à Tizi Hibel dans la région des Ath Douala, Feraoun a grandi en période de changement. Il a été admis à l’École normale de Bouzaréah à Alger en 1932 et est devenu professeur en 1935. Son rôle d’instituteur était crucial, lui permettant d’être en contact avec la réalité des villages et d’observer les transformations engendrées par la guerre. Il a occupé différents postes dans l’éducation, ayant finalement atteint celui d’inspecteur jusqu’à son assassinat en 1962 par l’Organisation Armée Secrète (OAS), une action tragique qui a eu lieu juste avant la signature des accords d’Évian, qui ont officiellement mis fin à la guerre.
Feraoun était profondément attaché à son pays et à son peuple. Son regard lucide sur la condition algérienne et sa façon de l’exprimer à travers la littérature ont fait de lui un pilier de la culture algérienne. Son œuvre continue d’inspirer de nombreux lecteurs et intellectuels, soulignant l’importance de la mémoire collective et de la résistance face à l’oppression.
En conclusion, Mouloud Feraoun est bien plus qu’un écrivain ; il est un symbole de la lutte algérienne pour l’indépendance. À travers ses écrits, il a su capturer l’essence de son époque, reflétant les douleurs et les luttes de son peuple, tout en nourrissant l’espoir d’une nation libre. Son héritage perdure, prouvant que la littérature peut être un puissant vecteur de changement social et de prise de conscience politique.